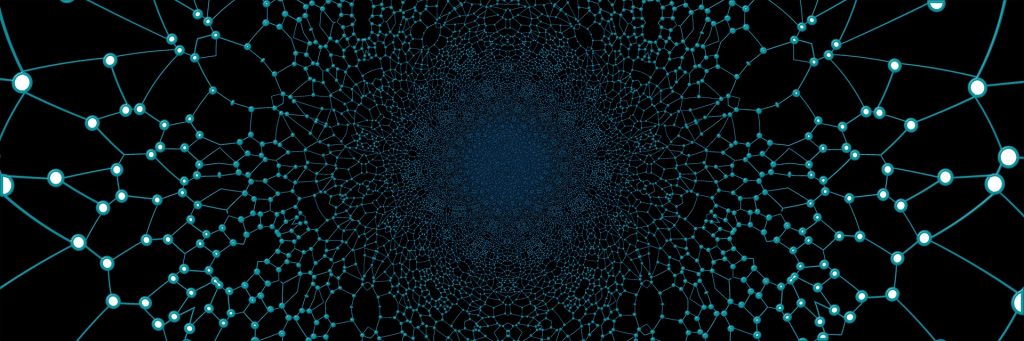
Bien que dans l’espace public vous êtes présenté comme Laurent Turcot, l’historien, comment décririez-vous ce que vous faites?
LAURENT TURCOT En fait, c’est carrément ça! Je suis un historien dans le sens très large du terme. Autant je travaille sur les traces du passé pour essayer de révéler un sens, autant je tente de servir la société par ma fonction. Bien qu’il soit crucial que de la recherche fondamentale se fasse en histoire, je me vois aussi comme un passeur. Je dois dire que j’évite d’utiliser le terme « vulgarisation ». Je préfère utiliser celui de « transmission des connaissances » puisqu’il est moins connoté négativement au Québec. Pour faire bref, c’est comme ça que je me vois : je suis un historien qui fait de la recherche fondamentale, mais un pan de ma carrière est consacré à la diffusion pour servir à l’esprit public dans le domaine qui est le mien, bien sûr.
Qu’est-ce qui vous a amené à investir l’espace public comme vous le faites? Racontez-moi cette histoire.
LAURENT TURCOT Plusieurs choses! J’ai fait ma thèse en France et ma directrice de thèse, Arlette Farge, était assez présente dans les médias. Aussi, il y a beaucoup plus d’émission d’histoire là-bas qu’il y en a ici, ce qui fait en sorte que ça crée un public. Pour moi ça allait comme de soi que j’allais m’investir dans l’espace public. Mais, ça dépend de chaque personne. C’est-à-dire qu’il faut avoir envie de s’engager en ce sens. Me concernant, j’ai toujours beaucoup aimé le théâtre. J’ai même voulu faire du théâtre. Je me rends compte que je n’étais peut-être pas le meilleur, mais j’avais un besoin de dire, de raconter. Et ce besoin, je le comble par l’enseignement. On doit beaucoup s’exprimer lorsqu’on donne un cours.
Mon déclic a été quand j’ai été consultant historique pour « Assassin’s Creed Unity » qui est un jeu fait par Ubisoft. Là je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j’avais travaillé dans ma thèse qui se retrouvaient maintenant dans un jeu sorti à des millions d’exemplaires. Je me suis dit : « il y a carrément un public pour ça ». Les historiens ont une utilité sociale.
Mais, entre le désir et la réalité, il y a toujours un monde. Ce n’est pas parce que] tu désires être dans l’espace public que nécessairement le public va t’accueillir. Il y avait déjà des historiens et des historiennes qui étaient là quand j’ai voulu faire le grand saut. C’est tranquillement que l’on créer notre créneau, puis on étend. C’est de cette manière qu’on se construit. Ça fait peut-être 15 ans que je m’investis dans l’espace public de manière régulière, et il y en a qui ne me connaissent pas et pensent que je viens tout juste d’arriver. Pourtant.
Y a-t-il eu un évènement qui vous a fait gagner en popularité?
LAURENT TURCOT Oh oui! Je serais fou de ne pas reconnaitre. Ç’a été « Tout le monde en parle ». D’autant plus que c’était le premier épisode de la saison en direct à la suite de l’annonce de la pandémie : beaucoup de gens l’on visionné. J’ai eu un segment de 7 ou 8 minutes pour parler de l’histoire des pandémies. Ç’a été un gros déclic. Ma chaine YouTube « L’histoire nous le dira » a explosé en moins d’une semaine. Elle a gagné 15 000 abonnés. C’est fou de dire que les médias traditionnels sont en perte de vitesse parce que je le vois quand je fais des entrevues à la radio, à la télévision ou encore ailleurs que ça a un effet sur mes réseaux sociaux. Ce n’est donc pas à négliger.
Dans un sondage mené par la firme SOM en 2020, les Québécois disent avoir confiance dans la science, en les chercheurs, mais considèrent que les chercheurs devraient davantage faire part de leur recherche au grand public. Les réseaux sociaux peuvent être de bons canaux pour joindre le grand public. Que dites-vous aux professeurs et aux chercheurs qui disent ne pas être intéressés par les réseaux sociaux ou regardent peut-être ces médiums de haut?
LAURENT TURCOT En fait, je peux comprendre! Ce qui n’est pas à faire c’est de juger, de critiquer et de penser qu’on est meilleur que les autres, et ce, que ce soit d’un côté comme de l’autre. Ce n’est pas parce que tu fais de la diffusion sur les réseaux sociaux que tu es meilleur que les autres et ce n’est pas parce que tu n’en fais pas que tu es moins bon que les autres. C’est aussi une question de génération. Il y a des générations qui ne sont pas nées avec ça, qui les ont vu se construire, mais qui ne voient pas l’intérêt. Et même ma génération, j’ai 42 ans, et il y a des réseaux sociaux avec lesquels je suis beaucoup moins à l’aise. J’ai seulement à penser à Snapchat ou TikTok. Cependant, ça ne veut pas dire qu’il faut s’en couper pour autant. Je pense, au contraire, qu’on doit les investir.
Le temps qu’un chercheur investit sur les réseaux sociaux c’est du temps en moins consacré à leurs publications, et pour certains, le cout d’option est assez facile. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi considérant que c’est la fonction première de l’université. Cependant, il serait intéressant que des espèces d’équipes affiliées aux différentes universités puissent aider les chercheurs à s’investir davantage sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que tout ce que je fais sur les réseaux sociaux c’est beaucoup de connaissances techniques et ça prend du temps à acquérir ce type de connaissances. Il y a beaucoup d’essai et erreur. Lorsque quelqu’un est habitué à monter des vidéos et de coder, par exemple, ça va beaucoup plus vite. Encore là, il faut prendre le temps, et les chercheurs ont très peu de temps.
Les grands médias (télé, radio et journaux) sont une façon de joindre le grand public. Cependant, souvent on demande aux experts de se prononcer sur des sujets de nature sociale assez complexes en peu de temps. Comment y arrivez-vous?
LAURENT TURCOT Une formation en histoire ça permet d’assez bien de le faire et, en général, les chercheurs sont habitués à le faire. Je donne souvent l’exemple des comptes rendus : demander à un scientifique de lire un ouvrage de 600 pages, mais de faire un résumé de seulement 700 mots. Ils ont l’habitude de faire ça. De la même manière lorsqu’on enseigne, on est capable de résumer une séance de trois heures en un paragraphe.
Autant, j’ai envie de dire que c’est inscrit dans la génétique du chercheur, autant il faut se rompre à l’expérience du média pour se rendre compte de la manière dont le tout fonctionne. Comme n’importe quelle autre forme de diffusion, les grands médias ont leurs codes : les codes techniques qu’il faut apprendre à maitriser, mais aussi les codes de l’animateur qui t’amène à un endroit que tu n’avais pas prévu. Retomber sur ses patins après un salto arrière, ce n’est pas toujours chose facile. Et un élément pour se sortir d’une question assez difficile d’un animateur, par exemple, c’est l’érudition. Plus tu vas connaitre de choses, plus tu vas être en mesure de patiner sans que ce soit quelque chose de désagréable. C’est pour ça que les gens qui pensent faire une carrière en vulgarisation scientifique, c’est tout à fait possible, mais il faut être énormément chargé sur le plan des connaissances. En ce qui me concerne, je n’arrête pas de lire, je n’arrête pas de me tenir au courant. Alors que le scientifique cherche d’abord et avant tout ce qui se trouve dans son champ d’intérêt, le vulgarisateur s’intéresse à tout. Parfois, je me commande des livres sur l’histoire antique bien que je ne suis pas antiquisant ou sur l’histoire médiévale. Je me suis donné une liberté avec ma chaine YouTube que d’autres n’ont pas. Si j’ai envie de parler pendant 45 minutes sur un sujet, je le fais et personne ne va me couper, ce qui ne serait pas le cas avec une chronique de 12 minutes sur les ondes de Radio-Canada.
Que diriez-vous à la relève qui envisage une carrière de chercheur en sciences sociales et humaines, en histoire?
LAURENT TURCOT Il va toujours avoir de la job. C’est ça l’affaire. Ce n’est pas demain matin qu’il va y avoir des usines d’historiens ou de professionnels en sciences humaines qui vont ouvrir, mais on a toujours besoin de gens qui savent penser! Penser efficacement.
Même si l’Internet était présent lorsque j’ai fait mon baccalauréat, on se servait davantage des fiches. On allait à la bibliothèque et on vidait les rayons. On nous a appris à décliner rapidement un sujet et d’en sortir quelque chose d’intéressant. Et lorsqu’on y pense, c’est exactement ce qu’on demande à un journaliste, mais sur des sujets un peu plus explosifs, disons-le comme ça!
Bref, il faut garder en tête qu’il y a en a de la job. Si on fait ça par passion, on n’aura jamais l’impression de travailler de sa vie. Je dis ça, mais je suis bien conscient qu’il faut gagner sa vie, mais j’y crois!







