Parlez-nous de l’histoire derrière la page Instagram Lions-nous ?
Audrey-Ann Lefebvre : Au cours de notre parcours doctoral, nous avons constaté qu’une grande quantité d’informations circulait sur les réseaux sociaux. Toutefois, ces informations n’étaient pas toujours fiables ni fondées sur des données probantes. On y trouvait souvent de la désinformation, notamment en ce qui concerne les relations interpersonnelles. Sans compter qu’en tant que futures psychologues cliniciennes, nous avons remarqué que certaines personnes qui consultaient rapportaient parfois des informations erronées ou utilisaient des terminologies non scientifiques véhiculées sur les réseaux sociaux. Cela entrait en contradiction avec notre posture professionnelle.
Pour contrer cette tendance, nous avons décidé d’exploiter les plateformes où se retrouvent ces informations, c’est-à-dire les réseaux sociaux. En effet, ceux-ci sont très populaires chez les jeunes adultes, soit la tranche d’âge que nous désirions cibler pour démystifier les relations interpersonnelles à l’aide de la diffusion d’informations fiables basées sur la science.
Parallèlement à tout ça, une initiative existait déjà pour diffuser les travaux de recherche des personnes étudiantes au sein du Laboratoire de recherche de psychologie du couple et de la sexualité, dirigé par notre directrice, la Pre Audrey Brassard. Cependant, cette diffusion était principalement consultée et accessible au public universitaire ou professionnel au Québec. Par exemple, les contenus diffusés étaient surtout des présentations lors de congrès ou des articles scientifiques en anglais, des formats moins accessibles.
Nous avons alors décidé d’élargir nos modes de communication pour toucher un public plus large en utilisant les réseaux sociaux. Cela nous permettait aussi de faire preuve de plus de créativité dans nos communications, contrairement à une page professionnelle sur Facebook, qui tend à être plus formelle. Ainsi, nous pouvions atteindre un public différent avec une approche plus adaptée.
Quels impacts souhaitez-vous laisser en vulgarisant sur les relations interpersonnelles avec votre page Instagram ?
Anne-Laurence Gagné : Notre plus grand souhait est de rendre les connaissances scientifiques plus accessibles pour avoir un impact positif sur le bien-être des gens. Nous espérons notamment encourager une meilleure communication entre les individus afin de rendre leurs relations plus épanouissantes. En abordant de manière simple et claire des sujets souvent ignorés ou considérés comme tabous, tels que la sexualité ou la violence dans les relations intimes, nous souhaitons briser ces tabous et ouvrir un dialogue. Nous espérons ainsi éveiller la curiosité de certaines personnes, qui pourraient ensuite partager ces réflexions avec d’autres, favorisant ainsi le partage de confidences.
Nous constatons déjà un impact concret, puisque nous recevons des messages qui montrent qu’une réflexion s’amorce chez les gens. Nous espérons que ces discussions se propageront au sein de leur entourage, et pas seulement avec nous. Cela pourrait marquer le début d’un changement. Nous souhaitons également que, en offrant des informations dans un langage adapté, chacun puisse mieux comprendre ses besoins, favorisant ainsi une introspection. Nous pensons qu’en allant dans cette direction, nous contribuons à créer une société plus en santé. C’est une perspective très optimiste, mais c’est ce que nous espérons!
Nous aimerions également développer chez les gens le réflexe de chercher des informations fiables et de cultiver leur esprit critique, afin de distinguer ce qui est validé de ce qui ne l’est pas. C’est un objectif qui nous tient à cœur.
Comment arrivez-vous à concilier vos activités doctorales à celles de votre projet de vulgarisation scientifique ? Est-ce réellement possible ?!
Audrey-Ann Lefebvre : La réponse courte serait que oui, c’est possible, mais ça vient tout de même avec des défis. Ça nécessite définitivement une répartition claire des tâches au sein de l’équipe afin qu’une seule personne ne se retrouve pas à porter toute la responsabilité d’un projet aussi important. Il est essentiel de s’entourer d’une équipe avec laquelle on s’entend bien, qui partage les mêmes objectifs, la même vision, et qui adopte des méthodes de travail similaires. S’allier à des personnes avec qui on a une bonne entente est un atout majeur. Ça permet d’éviter les accrochages et, pour moi, il est important que le travail soit plaisant.
Par exemple, une des choses que j’apprécie particulièrement du travail, c’est de découvrir les nouvelles publications créées par les personnes étudiantes impliquées dans le projet, d’être surprise par leur créativité, leurs nouvelles idées, et la manière dont elles amènent les concepts. Je trouve cela très plaisant de les soutenir dans leur démarche en tant que co-fondatrice du projet.
Dans un autre ordre d’idées, ce qui peut être plus difficile, c’est de bien compartimenter les tâches liées à l’avancement de la thèse, que ce soit la complétion des cours ou encore la rédaction de la thèse. Je dirais qu’il est crucial de bien s’organiser pour que ça n’entrave pas le progrès de nos études. C’est facile, par exemple, de se laisser distraire par les notifications sur Teams ou les courriels pendant la journée de travail, ce qui peut interférer avec l’avancement de nos tâches. Il est donc important de se munir de bonnes stratégies efficaces pour jongler dans nos divers projets.
Anne-Laurence Gagné : J’aimerais souligner l’importance de la communication au sein de l’équipe. Il est essentiel de se sentir en confiance avec ses collègues, de savoir que l’on peut compter les uns sur les autres et déléguer certaines tâches sans craindre de se faire reprocher de le faire. Il s’agit d’une dynamique que nous avons instaurée et qui nous est très bénéfique.
Parlant de dynamique, il est important de ne pas instaurer une pression destinée à ce que tout soit parfait au sein de l’équipe. Les erreurs sont inévitables, et il est donc essentiel d’avoir une certaine latitude et bienveillance les uns envers les autres. Cet état d’esprit contribue à rendre notre collaboration agréable, en évitant de transformer chaque petit problème en un fardeau.
Côté organisation, je réserve des plages horaires spécifiques pour certaines tâches. Par exemple, je réserve un créneau dédié à la rédaction de mon article de thèse, où je m’assure qu’aucune notification ne viendra me déranger : Teams est fermé, les courriels sont fermés. De la même manière, je prévois dans mon agenda une heure, par exemple, pour la révision des publications de Lions-nous ou encore pour faire des suivis avec Audrey-Ann. Cette organisation m’aide énormément et m’a permis de ne plus culpabiliser lorsque je ne traite pas immédiatement une notification, car je sais qu’il y aura bientôt un moment où je m’en occuperai.
Aussi, dans notre équipe, nous précisons dès le départ qu’il peut y avoir des délais de réponse dans nos communications, qui peuvent aller de 24 à 48 heures, voire parfois un peu plus longtemps, en fonction de nos activités doctorales. Être transparent·e à ce sujet dès le début aide grandement à bien compartimenter ces deux aspects de notre travail.
Que diriez-vous à des personnes étudiantes qui hésitent à proposer un projet luttant contre la désinformation au programme de subvention REGARDS – ODD destiné à la relève étudiante ?
Audrey-Ann Lefebvre : C’est certain que se lancer dans une demande de subvention comme celle-ci permet de vraiment développer des compétences en leadership. Dans notre projet, nous nous occupons du recrutement des membres et de la gestion de l’avancement du travail. Ça nous permet également de renforcer nos compétences en planification et en communication, car établir des collaborations peut être intimidant et complexe. Ce projet nous a permis de prendre le rôle de responsable de projet, un aspect qui peut parfois être manquant dans certains programmes universitaires, où l’on n’a pas toujours l’occasion de diriger des projets de recherche. Cette opportunité est donc un excellent complément à notre formation, car cela nous permet de développer des compétences qui, autrement, n’auraient peut-être pas été acquises.
Anne-Laurence Gagné : Je dirais qu’il est normal de trouver intimidant d’écrire une demande de subvention, surtout en tant que personne étudiante, car ce n’est pas une tâche à laquelle nous sommes souvent confrontés. Cette tâche est généralement assumée par des personnes professeures ou plus avancées dans leur parcours, qui ont plus d’expérience en recherche. Un élément aidant lors de la rédaction d’une demande de subvention est de bénéficier du soutien de son équipe de direction de recherche et de pouvoir compter sur sa relecture avant la soumission.
Il est important de se rappeler que chaque initiative, même modeste, peut faire une différence. Il n’est pas nécessaire d’avoir toutes les réponses dès le départ, et il n’est pas indispensable que tout soit parfait et sans faille dès le début. Osons prendre des risques, surtout lorsqu’ils sont mesurés et calculés.
Ce programme est justement conçu pour nous aider à développer nos idées tout en étant entourés de personnes avec qui nous aimons travailler, et qui nous soutiendront et nous pousseront vers le haut dans notre créativité et nos réflexions. C’est vraiment précieux. En tant que personnes étudiantes, nous avons une perspective unique qui peut apporter des approches nouvelles et créatives. C’est un souffle d’air frais, et en partageant nos projets, nous nous engageons dans une réflexion collective sur des solutions à de nombreux enjeux. Pour nous, ce sont les relations interpersonnelles, mais ça pourrait tout aussi bien concerner les changements climatiques ou les inégalités sociales.
Audrey-Ann Lefebvre : Aussi, il faut s’attendre à devoir faire preuve d’une grande capacité d’adaptation, ou du moins être prêt à la développer, car les réseaux sociaux sont en constante évolution. Ce qui fonctionnait hier ou la semaine dernière peut ne plus être efficace aujourd’hui, et il est souvent nécessaire de revoir notre approche. Les réseaux sociaux et les plateformes évoluent constamment. Il faut aussi s’autoriser à faire des erreurs, car parfois, une fonctionnalité peut sembler prometteuse, mais en pratique, des obstacles peuvent être rencontrées en cours de route.
Par exemple, nous avions de belles idées pour créer des « reels », mais nous avons finalement réalisé que ce n’était peut-être pas le format le plus adapté à notre contenu, qui reste tout de même assez formel. Nous avons donc dû nous ajuster et opter pour des formats plus courts, comme des extraits ou des carrousels. Il est crucial d’observer ce qui fonctionne et de s’orienter dans cette direction, mais il faut aussi être prêt à accepter qu’il soit parfois nécessaire d’effectuer des changements en cours de projet.
Anne-Laurence Gagné : Une autre compétence que je pense que nous avons développée à travers ce projet est la pensée critique, ainsi que la capacité à faire des nuances. Il s’agit de bien savoir partager une connaissance, surtout lorsque certains sujets que nous abordons sont sensibles. Ce projet nous a vraiment poussées à réfléchir l’angle de traitement des publications, et à choisir les mots appropriés pour le faire. L’objectif est d’éviter que nos publications transmettent un message différent de celui que nous souhaitons. C’est une compétence qui, selon moi, a été grandement favorisée grâce à ce projet.
|
Pour plus de contenus scientifiques vulgarisés sur les relations intimes et amicales, abonnez-vous à leur compte Intagram @Labo_nous. |
|
Le programme de subvention REGARDS – Objectifs de développement durable (ODD) offre à la relève étudiante l’occasion de proposer des projets de communications numériques (vidéo, balado, blogue) visant à échanger et à sensibiliser les jeunes de 18 à 30 ans aux ODD. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter la page web des Fonds de recherche du Québec. |

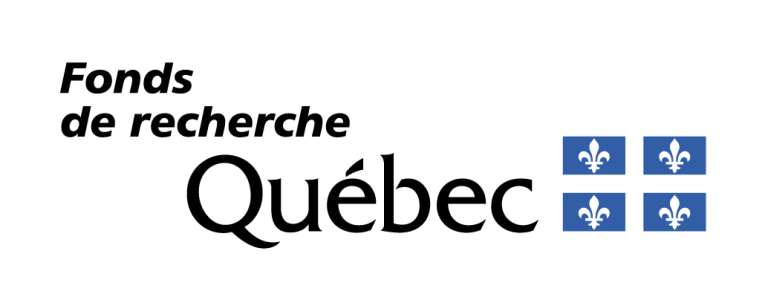
Découvre l'autrice

Juliette François-Sévigny
Juliette est étudiante au doctorat en psychologie au cheminement en intervention en enfance et adolescence à l’Université de Sherbrooke. Elle s’intéresse particulièrement à la réalité des parents ayant des enfants doublement exceptionnels. Dans ses temps libres, elle adore écouter des podcasts de tout genre, découvrir de nouveaux livres et marcher dans les magnifiques rues de Montréal.





